« Retour à lectures commentées
Thierry Chopin, Le bal des hypocrites, Paris, Saint Simon, 2008
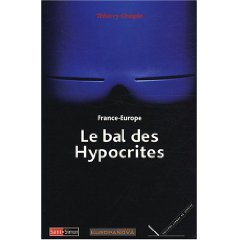
T. Chopin, Le Bal des hypocrites
La construction européenne n’est pas un long fleuve tranquille, elle est faite d’avancées, de soubresauts, de pauses, que seule une mise en perspective permet d’en saisir le fil directeur : la voie vers l’intégration.
Le récent ouvrage de Thierry Chopin, Le bal des Hypocrites, paru aux éditions Saint Simon en juin 2008, s’inscrit dans cette fertile voie.
L’auteur, directeur des études à la Fondation Schuman, s’est défait de ses habits de militants de l’Europe pour revêtir ceux de l’observateur intransigeant de la chose européenne. Balayant près de 60 ans d’histoire communautaire pour mieux souligner les défis actuels de l’Union européenne, Thierry Chopin allie souci pédagogique et réflexion originale dans un style clair, concis guidé par un souci permanent de qualification formelle, le tout rehaussé par quelques formules ciselées.
L’ouvrage est formé de trois parties ayant en commun la délicate question des relations entre la France et l’Europe, chacune d’elle formée à son tour de deux chapitres. La problématique de ces relations est renouvelée par le contexte né de l’élargissement. Parallèlement le tour pris par le développement de l’Europe témoigne de l’incapacité de la méthode fonctionnelle à la légitimer, méthode qui est fondée en substance sur la croyance selon laquelle l’Europe finira par emporter l’adhésion par ses réalisations. La crise de légitimité que traverse cette Europe élargie ne peut être dépassée selon l’auteur que par la politisation de l’Union.
A la lecture des premières pages, le projet de l’auteur apparaît, il s’agit de « réconcilier la France et l’Union européenne » (p. 20) après le refus des électeurs français de ratifier le traité constitutionnel le 29 mai 2005, refus dont les motivations premières sont présentées ici comme culturelles (pp. 14-16). Cette réconciliation passe par une exposition sans concession des origines de l’Europe communautaire et de sa réception par la France.
Telle est la trame du premier chapitre attaché à mettre en lumière les réticences françaises à l’égard du marché commun (p. 31) et les excès qu’il a pu nourrir (pp. 37-42), « la libéralisation européenne (étant) également confrontée à des limites factuelles » (p. 39). Si les ambiguïtés françaises ne sont pas ignorées (p. 33-34), la suffisance des partisans du traité-constitutionnel n’est pas masquée (p. 35).
Cette vision équilibrée des rapports entre la France et l’Union, inaugurant l’ouvrage, se retrouve au fil des pages et constitue assurément l’une de ses vertus. La pensée européenne de l’auteur n’est pas déformée par le prisme hexagonal comme c’est trop souvent le cas chez les contempteurs de l’Europe comme chez ses laudateurs.
Dans le chapitre suivant, à mille lieues des caricatures habituellement assénées par un camp comme par l’autre, l’auteur, sans abuser de statistiques, rapporte la preuve des bienfaits partagés du marché intérieur sur le terrain économique mais aussi social (pp. 47-51). Les pages qui suivent paraissent avoir été écrites pour ceux vantant les mérites d’un protectionnisme hors d’âge en ces temps de crises boursières et financières (pp. 67-74). L’environnement mondialisé de l’Europe loin d’être un fardeau est à juste titre présentée comme une chance pour la plupart des acteurs économiques européens, les autres, ayant à subir ses ravages sociaux ne sont pas ignorés comme le rappelle l’auteur avec la création d’un Fonds d’ajustement à la mondialisation injustement méconnu (p. 56).
Au terme de cette première partie, l’œuvre pédagogique a fait son chemin, le lecteur a les idées plus claires, le voile du manichéisme ambiant a été habilement déchiré.
La deuxième partie est consacrée au positionnement de la France dans une Europe élargie. Tout l’intérêt de la démonstration porte précisément dans le chapitre 3 sur la manière dont cet élargissement a été conduit et présenté par les autorités européennes, incapables de porter au crédit de l’Union l’espace de prospérité et de paix qu’il incarne (p. 79) ainsi que la « diffusion démocratique » qu’elle induit (p. 86). Tout le talent de l’auteur à briser les idées reçues sur l’Europe parcourt ce chapitre dans lequel loin d’opposer l’élargissement à l’approfondissement, est démontré que depuis 1992, l’un est allé de pair avec l’autre (p. 110-119). Sans Europe élargie à l’Est pas de Constitution européenne ! Pour autant cette extension territoriale ne peut être par nature illimitée comme aime à le rappeler T. Chopin (p. 87).
Si la question des frontières de l’Union est récurrente dans l’ouvrage, occupant une large part du chapitre 4, la déception pointe, jamais l’auteur n’apportant de réponses (la Mer noire ?, l’Oural ? la Russie ?...). En revanche est plus convaincante l’analyse du malaise de la France face à cette Grande Europe, qui ne saurait être « la France en grand » (p. 89). De là découle une difficulté ontologique pour l’Union du point de vue français : comment vouloir « l’Europe puissance » sans les attributs de la puissance ? La réponse à cette question passe en dernière analyse pour l’auteur par la rupture avec cette « illusion » d’une « Europe puissance » (p. 130), appelée à devenir un « acteur global » (p. 123) par une redéfinition de ces relations avec les Etats-Unis et la Russie (pp. 123-129). Au passage on regrettera que l’Inde et la Chine ne retiennent guère l’attention, toutefois la pertinence des perspectives dégagées n’est pas douteuse, elle sort même renforcée à la lumière de la crise géorgienne
La troisième partie, la plus technique, celle qui voit se déployer les aspects les plus originaux de l’essai est aussi, sans doute pour cette même raison celle qui paraît la moins convaincante. Il reste que dans le chapitre d’ouverture, le cinquième, l’analyse de T. Chopin peut être aisément partagée. Tel est le cas lorsqu’il souligne les insuffisances de la légitimation de la construction européenne attestant une fois de plus des limites de la méthode fonctionnelle (pp. 137-138), dues pour une large part dans la conviction des partisans de l’Europe que ses résultats suffisent à emporter l’adhésion, « en d’autres termes, l’exigence d’efficacité n’épuise pas la notion de légitimité » (p. 143), ou lorsqu’il doute de la pertinence des moyens censés y remédier, au premier rang desquels figure l’information (pp. 146-147). Cette démarche est typique de la Commission, qui, au moins depuis l’Acte unique, consacre maints rapports et communications à la nécessité de davantage informer les citoyens européens, avec le succès que l’on sait. Sans doute que l’auteur aurait pu approfondir sa critique tant l’idée est répandue dans l’élite européenne qu’un texte communautaire ne saurait être mauvais en soi ; si défaillance il y a, elle est toujours formelle, illustrative d’une mauvaise communication ou d’un déficit d’information et de pédagogie, mais jamais essentielle ou substantielle.
Précisément cette élite européenne, formée de « ceux qui savent et sont pour » (p. 150) attire les foudres de l’auteur à la fois parce qu’elle occulte le débat public s’agissant par exemple de l’élargissement (p. 153), parce qu’en France elle gère les affaires européennes « en vase clos » (p. 152), parce qu’elle est incapable d’aborder l’Europe autrement qu’en chaussant des lunettes déformantes (p. 151). Sans compter, comme se plaît à le rappeler l’auteur dans plusieurs passages consacrés à l’hypocrisie dirigeante (pp. 154-155), demandant aux Français de soutenir la construction européenne tout en lui imputant certaines réformes économiques et sociales impopulaires (pp .154-155). Ce double langage est en partie responsable du « non » français de 2005. A ces maux hexagonaux, T. Chopin ajoute la persistance d’une « passion jacobine pour l’unité et l’indivisibilité » de la souveraineté du peuple se conciliant mal avec les développements de l’Europe communautaire (p. 155 à 160).
Après la phase de déconstruction, vient naturellement celle de reconstruction, tâche à laquelle s’attelle l’auteur dans son dernier chapitre, le sixième, accordant une large place aux dispositions du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007. L’idée centrale qui occupe l’auteur tient en peu mots : la politisation de l’Union. Celle-ci est pensée comme assurant à la fois une plus grande légitimation à l’Union et un meilleur fonctionnement institutionnel. On doit à la vérité de dire que cette idée, présente notamment dans un document de la Fondation Schuman (Questions d’Europe n°78, 5 novembre 2007, Le traité réformateur : vers une Union européenne politique ?), ne nous paraît pas de nature à prospérer. Ce n’est pas tant l’objet en lui-même qui prête à discussion que l’analyse de ses manifestations. De plus, si l’Europe se doit d’être « saisie par la politique » (p. 164), il s’agit moins d’un processus en cours, que d’une réalité : qu’est-ce que le refus français ou irlandais de ratifier un traité si ce n’est l’expression d’une volonté politique ?
La politisation de l’Union se trouve ailleurs, elle est à rapprocher de sa « démocratisation ». Pour les besoins de la démonstration, T. Chopin écarte quatre visions de la politisation de l’Union, clairement identifiées (p.167 à 170) pour mieux présenter la sienne (p. 173 à 175). Le moins que l’on puisse dire est que sa définition ne va pas de soi. Autant les conceptions habituelles de la politisation ont des contours définis, celle retenue souffre d’un défaut congénital : son flou conceptuel. L’auteur en fait l’aveu : « Par définition, la politisation est un processus de long terme, sujet à des variations de conjoncture, à l’influence de telle ou telle personnalité concrète, et qui ne saurait par conséquent être décrétée » (p. 175).
S’en remettre aux hommes et aux circonstances plus qu’aux institutions et à la règle de droit n’est qu’un pêché véniel pour celui qui reste attaché à la réalité des choses. C’est sur un autre terrain que se focalise les reproches : les exemples censés illustrer ce processus. D’abord, les travaux de la Convention européenne sont analysés comme apportant « un élément de politisation supplémentaire » en ce qu’ils ont débouché sur des symboles politiques comme la référence à une Constitution (p. 173). Cette croyance dans la force des symboles est discutable mais surtout elle souffre d’un pêché logique, car comment voir dans ces symboles la manifestation d’un processus de politisation à l’œuvre et continuer de l’observer alors même qu’ils disparaissent du traité de Lisbonne (p.174). L’explication tenant dans des habitudes médiatiques où par commodités on continue de parler de Constitution pour désigner les traités européens est non seulement courte (p. 175) mais surtout démentie par les faits, le traité de Lisbonne ayant tout aussi abusivement été présenté a minima par les médias, tantôt comme un mini-traité, un traité simplifié, plus rarement un traité réformateur, après tout ne le sont-ils pas tous ? De plus, s’il est exact que le recours à une Convention pour les futures révisions du traité est prévu, il ne joue pas automatiquement, et en aucun cas il n’ôte aux Etats le dernier mot, restant les maîtres des traités et de leur révision.
T. Chopin déplace ensuite son argumentation des symboles vers les textes et la pratique institutionnelle, appréhendés sous l’angle de ce processus de politisation. Les relations entre le Parlement européen et la Commission fournissent le gros de l’argumentation. Le traité de Lisbonne en prévoyant que le président de la Commission est désigné sur proposition du Conseil européen par le Parlement européen « en tenant compte » des élections européennes témoignerait de cette politisation. Le caractère novateur du dispositif est à nuancer, car depuis le traité de Nice, la désignation du président de la Commission est soumise à l’approbation des députés européens, de sorte que sans le dire, les chefs d’Etat ou de gouvernement tiennent compte de la composition du Parlement européen. Ainsi, la « nouvelle logique » invoquée (p. 177) n’est qu’apparente, d’autant plus que le rôle du Conseil européen reste central, comme aujourd’hui la désignation du président de la Commission est à la croisée de la légitimité interétatique et démocratique, il y a peu de choses à attendre sur ce point du traité de Lisbonne. Comme il est douteux que ce mécanisme de désignation conduise à « politiser les élections européennes » (p.177). A défaut de listes transnationales et de véritables partis politiques européens, hier comme demain, les élections européennes ne seront jamais que 27 élections nationales ayant pour objet de désigner des députés dans les 27 Etats membres afin de siéger au Parlement européen ! Le fort taux d’abstention aux dernières élections de 2004, le plus élevé jamais relevé, ne laisse guère présager de changements dans les comportements électoraux. En conséquence, il est vain d’attendre, comme l’auteur, des citoyens qu’ils exercent une influence sur la conduite des politiques de l’Union (p. 178).
N’est pas davantage envisageable l’apparition « d’un véritable leader politique » (p. 178) au moment même où un acteur institutionnel fait son apparition : le président du Conseil européen. Il n’est d’ailleurs pas certain que le Conseil européen et le Parlement européen aient intérêt à choisir une personnalité susceptible d’incarner ce leader, si tant est que cette perspective existe. En réalité, et la crise financière de l’automne 2008 le démontre amplement, le leader de l’Europe est à chercher plus du côté de la présidence du Conseil européen que de celle de la Commission. Plus loin d’ailleurs, T. Chopin voit dans le président du Conseil européen « un troisième personnage clé du niveau politique européen » (p. 181), le deuxième étant… le président du Parlement européen, dont nombre de citoyens européens seraient bien en peine de citer le nom (l’allemand Hans-Gert Pöttering).
D’autres ressources comme la tenue de séances publiques du Conseil lorsqu’il agit comme législateur ou le droit d’initiative populaire sont excessivement mobilisées. La publicité des travaux du Conseil existe depuis le traité d’Amsterdam, cette disposition n’a pas rendu plus transparente auprès du public les décisions prises en son sein. Quant à l’initiative populaire, sa réalisation est suspendue au bon vouloir de la Commission.
Enfin, l’examen de la politisation revêt une dimension nationale. Pour cette raison, l’auteur analyse les rapports entre la Vème république et l’Union. Si le constat d’une insuffisante association « du Parlement français au contrôle de l’action communautaire » (p. 185) est aisé à partager, les moyens d’y remédier divisent. La transformation des organes parlementaires chargés des affaires européennes (les délégations) en commission (p. 186) – réalisée formellement par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 - ne paraît pas de nature à améliorer la situation. Car en définitive, et quels que soient les instruments parlementaires mis en oeuvre, leur degré de sophistication, rien ne laisse présager un contrôle approfondi sur l’action du gouvernement en matière européennes en raison de l’état de subordination dans lequel se trouve la majorité parlementaire. A supposer que la volonté politique existe, il est abusif de voir dans le Parlement français un acteur susceptible d’exercer une influence forte sur les affaires européennes en particulier alors même qu’il est affaibli en général par son positionnement constitutionnel et son panurgisme politique. En d’autres termes, ses difficultés à exister en matière européenne ne sont que le reflet d’une impuissance plus large, ce que l’auteur reconnaît plus loin volontiers (p. 192).
La voie d’une action concertée des parlements des Etats membres semble plus fructueuse (p. 190), mais elle présente deux graves inconvénients. D’une part, le risque d’un conflit de légitimité avec le Parlement européen est réel et ne doit pas être négligé, d’autre part, la perspective d’une « renationalisation » du processus de décision n’est pas non plus à écarter. En creux, il est permis de voir dans cet appel aux Parlements nationaux l’aveu de l’incapacité actuelle du Parlement européen à incarner pleinement le pôle d’une légitimité démocratique. Pourtant c’est sur lui que l’auteur fonde largement le processus de politisation.
Il n’en demeure pas moins que du point de vue strictement institutionnel, la place du Parlement européen dans le système communautaire n’a cessé de croître depuis 1970. Aussi, le « désintérêt de la France pour le Parlement européen » (p.193) n’en est que plus condamnable. Les moyens avancés pour y remédier par T. Chopin n’alimente guère la discussion : revoir le mode de scrutin des députées européens français (p.196) ; interdire le cumul de tout mandat avec celui de député européen (p .197). Au final, il en va de l’influence de la France au sein de l’Europe communautaire et de sa place afin qu’elle puisse « opérer un véritable "retour en Europe" (p. 200). Ce thème occupe la conclusion, émaillée des conditions nécessaires à une relance communautaire.
Rédigé avant le « non » irlandais, l’ouvrage de T. Chopin n’a pas à souffrir de ce contexte ; les analyses développées, la réflexion engagée et les pistes suggérées rendent sa lecture indispensable à qui veut mieux connaître et comprendre l’Europe, mais aussi les sentiments quelle inspire à la France. Le voeu ultime de l’auteur de voir « la France (…) de retour dans une Europe relancée » (p. 214) est en passe de se réaliser, dans des conditions qu’il était sans doute loin d’imaginer, mais qu’au final tout européen aurait tort de regretter. Car si l’on en croit T. S. Kuhn : « La crise signifie qu'on se trouve devant l'obligation de renouveler les outils » (La structure des révolutions scientifiques ; 1972). C’est à cette obligation que contribue utilement le livre de T. Chopin.
Didier Blanc
MCF droit public - UVSQ